Bases d'électrotechnique
Electrostatique et électricité
L'électricité n'est pas une découverte moderne. Elle est connue depuis les Grecs ! L'ambre jaune (résine fossilisée) fût l'un des éléments qui nous permis cette découverte. En effet, on observait qu'en frottant une baguette d'ambre avec une peau de chat, on pouvait attirer spontanément des poussières ou des petits copeaux de sureau. On observait le même phénomène avec une baguette de verre.
Inventeur entre autres du paratonnerre, Benjamin FRANKLIN fît d'autres expériences et parla d'électricité positive et négative. Ses travaux furent variés et servirent de base aux futurs chercheurs.
De nombreux progrès fûrent possibles grâce à des hommes comme Alessandro Volta, André-Marie Ampère, Michael Faraday...
Notion fondamentales d'électrostatique
Électrisation
Prenons un bâton de résine ( ambre jaune = élektron en grec) et frottons le avec un morceau de laine ; le bâton acquiert la propriété d'attirer les corps légers comme les confétis de papier ou des petites sphères de moelle de sureau. On dit que le bâton de résine s'est électrisé , il y a électrisation de la résine (figure 1).
Différent types d'électrisation
Électrisation par frottement
Répétons l'expérience avec un bâton de cuivre tenu à la main, nous n'observons plus aucune action sur les corps légers.
Si nous prenons la précaution de tenir le morceau de cuivre par un manche de verre, l'électrisation apparaît.
Expliquation
D'une façon générale, tous les corps peuvent s'électriser par frottement, mais il faut les classer en deux groupes :
- ceux qui se comportent comme la résine dont la charge électrique reste localisée sur la partie du corps frotté. Ce groupe contient tous les corps que nous appelons les isolants ; résine, verre, ébonite, soufre...
- ceux qui se comportent comme le cuivre dont la charge électrique se déplace le long du corps frotté. Dans ce cas cette charge à circulé le long du bâton de cuivre, a traversé le corps de l'expérimentateur et est retournée à la terre.
L'électrisation n'apparaît que s'ils sont tenus par un manche isolant ; ce groupe contient tous les corps que nous appelons les conducteurs : métaux, graphite...
Quand un corps n'est pas électrisé, il est dit à l'état neutre.
Électrisation par contact
Nous suspendons une petite balle de moelle de sureau à un fil de soie. Approchons un bâton de verre électrisé de la balle de sureau et observons :
- la balle de sureau est attirée (figure 2a). figure 2a
figure 2a
- elle vient en contact avec le bâton de verre (figure 2b), figure 2b
figure 2b
-elle est ensuite repoussée par ce même bâton (figure 2c). figure 2c
figure 2c
Approchons maintenant un bâton de résine électrisé :
- la balle de sureau est attirée (figure 2d). figure 2d
figure 2d
Expliquation
La balle de sureau était à l'état neutre au départ de l'expérience. Elle s'est électrisée au contact du bâton de verre et à acquit une charge électrique. Il y a électrisation par contact.
Le bâton de verre et la balle étant maintenant de même charge électrique, ils se repoussent. On dit qu'ils sont de même signe.
A l'approche du bâton de résine la balle de sureau est attirée parcequ'elle est de charge électrique différente du bâton de résine. On dit qu'ils sont de signes contraires.
Conclusion
Il y a deux espèces d'électricité :
- l'une semblable à celle produite sur le verre est appelée positive (+).
- l'autre semblable à celle produite sur la résine est appelée négative (-).
- Les charges de même signes se repoussent.
- Les charges de signes contraires s'attirent.
Électrisation par influence
Approchons un isolant d'un corps chargé positivement. Les charges positives en excès du corps chargé positivement vont attirer les électrons de l'isolant qui vont se concentrer sur la partie la plus proche du corps (figure 3a).
Il y a électrisation par influence.
Matière, atome et molécule
La matière (de mater => mère) est présente autour de nous sous trois formes ou plus exactement trois états : solide, liquide et gazeux. Une substance comme l'eau pourra être de la glace, du liquide incolore ou de la vapeur d'eau selon la température et la pression exercée sur cette eau. Mais sous n'importe quelle forme que ce soit l'eau est formée par les mêmes atomes et c'est l'organisation de ces atomes et molécules qui donnerons à l'eau sa forme solide (glace), sa forme liquide (incolore) ou sa forme gazeuse (vapeur invisible).
Organisation de la matière
Corps composés, corps simples
Les travaux des chimistes ont montrés que la matière pouvait se diviser en un certain nombre de corps simples purs (exemples : le fer, le cuivre, le sodium, l'oxygène, l'hydrogène...).
Ces corps simples peuvent s'unir entre eux pour former d'autres corps purs : ce sont les corps composés ou combinaisons.
De nombreux corps composés se trouvent dans la nature (exemples : le chlorure de sodium ou sel de cuisine, le carbonate de calcium ou marbre ...).
Un corps composé est toujours constitué par les mêmes corps simples et dans les mêmes proportions.
La molécule
{ du latin môle "masse" }
La molécule est la plus petite partie d'un corps pur susceptible d'exister à l'état isolé en gardant les caractères de ce corps.
Une molécule est formée d'atomes.
- dans un corps simple, elle est formée d'un ou plusieurs atomes semblables,
- dans un corps composé, elle est formée d'atomes différents
Atome
{Du grec "impossible à diviser", de a- --> "anti" ,"impossible" et -tome -->"temnein" ; "couper"}
L'atome est la plus petite partie d'un élément chimique à l'état électrique neutre. Il est susceptible d'entrer dans les combinaisons chimiques avec d'autres atomes pour constituer des molécules. L'atome est constitué d'un noyau atomique (protons, neutrons) autour duquel gravitent des électrons répartis sur une ou plusieurs orbites ou couches.
La molécule d'eau (H2O) contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.
Particules élémentaires
{Particule : très petite partie}
{Elémentaire : simple}
Électron : particule élémentaire contenant la plus petite charge d'électricité négative. Sa masse au repos est égale à la 1836 ème partie de celle de l'atome d'hydrogène.
- Charge de l'électron : 1,6 x 10-19 Coulomb (charge élémentaire => e).
- Masse de l'électron : 9,10938 x 10-31 Kilogramme.
Proton : particule élémentaire contenant la plus petite charge d'électricité positive.
Neutron : particule élémentaire électriquement neutre dont la masse est sensiblement égale à celle du proton.
Le noyau atomique chargé positivement contient presque toute la masse de l'atome. Il est constitué par la réunion de protons et neutrons sauf pour l'hydrogène dont le noyau se réduit à un proton. L'atome est électriquement neutre puisqu'il a autant de charges positives (les protons) que de charges négatives (les électrons) et que ces charges de sens contraires s'attirent.
Le diamètre d'un atome est compris entre 0,1 et 0,4 millimicron.
L'atome d'hydrogène est le plus simple de tous :

1 proton
1 électron
ATOME D'HYDROGENE

8 électrons
8 protons
8 neutrons
==> 16 est le nombre de masse (8 protons + 8 neutrons)
ATOME D'OXYGENE
Le nombre de masse correspond au nombre total de protons et de neutrons constituant le noyau atomique.
Relation entre l'atome et l'électricité
Couche électronique
Les électrons qui gravitent autour du noyau sont répartis sur plusieurs couches en fonction de leur niveau énergétique.
Les électrons périphériques appartiennent normalement à la couche électronique externe qui intervient dans les phénomènes lumineux, dans les phénomènes de conduction, ainsi que dans les propriétés chimiques de l'atome.
La couche externe ne peut contenir plus de 8 électrons.
On peut classer les atomes à partir de cette couche :
Les atomes ayant 1, 2 ou 3 électrons sur la couche périphérique ont tendance à les perdre.
Les électrons deviennent libres. C'est le cas des bons conducteurs électriques.
Les atomes ayant 5, 6 ou 7 électrons sur cette couche ont tendance à compléter cette dernière à 8.
C'est le cas des isolants.
Les atomes ayant 4 électrons constituent la catégorie des semi-conducteurs.
Les atomes ayant 8 électrons périphériques n'ont aucune tendance. Ce sont les gaz rares.
Ions positifs, ions négatifs
Les électrons n'étant pas disposés sur une même orbite, nous concevons bien que les électrons les plus éloignés soient moins attirés par le noyau, donc plus faciles à soustraire à son attraction.
Si un électron quitte l'atome, l'équilibre de celui-ci est rompu. Un ion est donc un atome ou groupe d'atomes possédant une charge électrique totale non nulle.
En effet, si un atome perd ou capture un ou plusieurs électrons, la charge positive du noyau n'est plus entièrement neutralisée.
L'atome incomplet devient suivant le cas un ion positif ou un ion négatif.
Classification périodique
Elle est due au chimiste russe Mendéléïev qui la publia en 1870. Les éléments sont placés les uns à la suite des autres, le nombre atomique augmentant chaque fois d'une unité. On revient à la ligne chaque fois que commence une nouvelle couche électronique.
Les éléments d'une même colonne appartiennent à la même famille chimique et ont des propriétés voisines.
Liaisons entre atomes
Liaison ionique
Elle fait intervenir l'électrovalence correspondant à un gain ou une perte d'électron. Les ions ne sont pas liés (inexistence de la molécule à composé ionique). L'édifice est le résultat d'un équilibre entre les forces d'attraction et de répulsion électrostatique. C'est le cas des sels tel que le chlorure de sodium.
Liaison ionique : Chlorure de sodium Na Cl
Liaison covalente
Elle fait intervenir la mise en commun d'électrons entre les atomes. On obtient un véritable lien entre atomes (existence de la molécule). Molécule d'oxygène O2
Molécule d'oxygène O2
Dans les deux cas, les atomes tendent à avoir leur couche électronique externe complète (généralement 8 électrons).
Les liaisons covalentes sont toujours plus difficiles à rompre que les liaisons électrovalentes.
Cristaux
Un certain nombre de corps solides, en particulier les métaux, cristallisent, c'est à dire que les atomes sont rangés suivant un motif géométrique régulier (maille) qui se répète pour former un cristal.
Le motif et les dimensions des mailles permettent d'expliquer un certain nombre de propriétés physiques des corps correspondants.
Les figures ci dessus montrent la disposition des atomes de carbone dans les cristaux de diamant et graphite.
La différence de dureté en particulier est la conséquence de la nature cristalline, ainsi que la différence de conductivité (diamant isolant, graphite conducteur).
(1)
 (2)
(2)
(1) = Maille élémentaire du réseau cristallin du diamant
(2) = Maille élémentaire du réseau cristallin du graphite
définitions
Valence : c'est le nombre de liaisons chimiques qu'un atome peut avoir avec les atomes d'autres substances, dans une combinaison.
Le courant électrique
André Marie AMPERE. Physicien français (1775 -1836). Il étudia la physique, la chimie, les mathématiques et les sciences naturelles. Il fit des recherches fondamentales en électrodynamique. Il est l'inventeur des lois sur l’électromagnétisme.
Naissance d'un courant électrique
Si un conducteur est placé entre deux éléments chargés l'un positivement, l'autre négativement, les électrons libres du conducteur vont être attirés par l'élément positif. C'est ce déplacement d'électrons qui est appelé courant électrique.
Circuit électrique
Un circuit électrique simple est composé d'un générateur et d'un récepteur, reliés entre eux par des conducteurs.
- Le générateur électrique transforme une énergie quelconque en énergie électrique ; pile, accumulateur, dynamo, alternateur...
- Le récepteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie quelconque ; mécanique (moteur), thermique (lampe à incandescence , radiateur), chimique (charge d'un accumulateur).
- Les conducteurs électriques permettent le passage du courant électrique. Ils sont très souvent en cuivre ou en aluminium.
Effets du courant électrique
Branchons en série, comme indiquer sur le schéma, les récepteurs (lampe et cuve à électrolyse), l'interrupteur, le générateur et plaçons une aiguille aimantée (boussole) à proximité des conducteurs.
Nota : l'eau et la soude forment une électrolyte.
Si nous fermons l'interrupteur, le courant se manifeste par trois effets :
- effet thermique, le filament de la lampe rougit.
- effet magnétique, l'aiguille de la boussole dévie.
- effet chimique, du gaz se dégage aux niveaux des électrodes.
L'inversion des branchements sur les bornes du générateur entraîne l'inversion des effets magnétique et chimique.
Nous pouvons donc dire, d'après les observations, que l'effet chimique et l'effet magnétique du courant électrique sont polarisés (ils dépendent du sens du courant électrique).
L'effet thermique est quand à lui non polarisé.
Sens conventionnel du courant
Les découvreurs de l'électricité et de ses propriétés ont toujours raisonné en faisant circuler le courant électrique du + vers le - .
La recherche aidant, nous avons découvert que c'était l'inverse qui se produisait.
Mais par convention, à l'extérieur d'un générateur, nous dirons que le courant circule du + vers le - .
Symboles utilisés pour les générateurs


(1)Générateur tournant, (2) Pile, (3) Batterie d'accumulateurs
Exercices sur les effets du courant électrique
Quel est l'effet observé lors du passage courant électrique dans les exemples suivants ? (mettre une croix dans la case corespondante).
Quantité et intensité du courant électrique
Charles Augustin COULOMB. Physicien français (1736-1806). Il se dédia à l’étude de l’électricité et du magnétisme. COULOMB va déterminer les lois quantitatives d'attraction électrostatiques et magnétiques qui portent son nom. A la même époque, il introduit la notion, toujours actuelle, de moment magnétique.
Définitions
Lorsque l'interrupteur est fermé, les électrons se déplacent. Chaque électron possède une charge électrique. La quantité d'électrons se déplaçant dépendra de la durée de fermeture de l'interrupteur ainsi que du débit des électrons dans le circuit.La quantité d'électrons circulant est appelée quantité d'électricité. Elle est notée Q et se mesure en Coulomb (C).La durée de passage du courant est noté t et s'exprime en seconde.Le débit d'électrons est appelé intensité du courant. L'intensité est notée I et se mesure en Ampère (A). Le coulomb est la quantité d'électricité transportée par un courant d'intensité d'1 ampère pendant 1 seconde.
Remarque : un électron possède une charge électrique de 1,6 x 10-19 C.La quantité d'électricité se calcule en utilisant la relation : Q = I . t Q en CoulombI en Ampèret en seconde Si t est exprimé en heure, Q est obtenue en Ampère-heure. 1 Ah = 3600 C L'ampère-heure est l'unité utilisée pour indiquer la capacité d'une batterie d'accumulateurs, c'est à dire la quantité d'électricité qu'elle peut fournir.
Mesure de l'intensité d'un courant
On effectue cette mesure avec un ampèremètre. Le circuit électrique est ouvert et l'appareil est place en série.On peut également utiliser une pince ampèremètrique fermée autour d'un conducteur.
Lois fondamentales du courant
Montage série L'intensité est la même dans chaque lampe.Dans un circuit série, le courant est identique en tous points de ce circuit.I1 = I2 = I3 = I Montage en dérivationL'intensité n'est pas obligatoirement la même dans chaque lampe.Dans un circuit comportant des dérivations, la somme des courants entrant est égale à la somme des courants sortant.I1 + I2 = I
Tension et différence de potentiel
Alessandro VOLTA. Physicien italien (1745-1827). Il fit de remarquables études sur l’électricité. Il inventa l’eudiomètre et la pile qui porte son nom.
Définition de la Tension
Pour qu'un courant électrique circule dans un circuit, il faut qu'il y ait une différence de potentiel entre les bornes du générateur. Elle est également appelée TENSION aux bornes du générateur. Elle est notée U.
L'unité de mesure de tension est le VOLT (V) (du savant italien VOLTA)
Mesure de la tension
On effectue cette mesure avec un voltmètre relié en parallèle aux bornes de l'appareil dont on veut mesurer la tension.
Energie et puissance
Définition
Un corps possède de l'énergie lorsqu'il peut fournir du travail ou de la chaleur.
Quelques sources d'énergie
Le soleil, le bois, le charbon, le pétrole, le gaz, les matériaux nucléaires, les réserves d'eau, le vent ... sont des sources d'énergie.
Les formes d'énergie
L'énergie peut se présenter sous des formes très diverses :
- l'énergie mécanique qui se présente sous deux formes :
-> cinétique si les corps sont en mouvement (l'eau qui tombe d'un barrage)
-> potentielle si l'énergie est en réserve (l'eau stockée derrière un barrage)
- l'énergie thermique ou calorifique
- l'énergie chimique
- l'énergie rayonnante ou lumineuse
- l'énergie nucléaire
- l'énergie électrique
Unités d'énergie
L'énergie, comme le travail qu'elle peut produire, se mesure en Joules (J).
Elle se note W. ==> Exemple : W = 450 J
Dans certains cas, on utilise d'autres unités :
- la calorie : 1 cal = 4,18 J.
- la thermie : 1 Th = 1000000 cal
- le wattheure : 1 Wh = 3 600 J
-> le Kilowattheure : 1 KWh = 1000 Wh = 3 600 000 J
Transformations de l'énergie
Dans toute transformation, l'énergie se conserve en quantité. L'énergie produite et l'énergie "disparue" sont égales.
Exemple : un moteur électrique absorbe de l'énergie électrique et produit de l'énergie mécanique (rotation) et de l'énergie thermique (frottements et échauffement des fils).
Énergie électrique = Énergie mécanique + Énergie thermique
Dans cet exemple, seule l'énergie mécanique produite par le moteur est utile (Wu).
La chaleur qui apparaît est une perte (Wp). L'énergie électrique consommée par le moteur est l'énergie absorbée (Wa).
Nous avons donc la relation suivante :
Wa = Wu + Wp
Rendement énergétique
Le rendement est le rapport entre l'énergie utile (Wu) et l'énergie absorbée (Wa).
 Le rendement est toujours inférieur ou égal à 1.
Le rendement est toujours inférieur ou égal à 1.
Puissance
Notion de puissance
L'énergie peut produire un travail mécanique, c'est à dire un mouvement. Or un même travail peut être effectué en des temps différents.
Exemples :
- Un ouvrier monte sur son dos un sac de 35 kg au 4ème étage d'un immeuble ; il met 3 minutes.
=> Un monte charge peut faire le même travail en 20 secondes.
- Une camionnette de 500 kg de charge utile fera 10 fois plus de voyages qu'un camion de 5 tonnes pour transporter 10 tonnes de marchandises.
Pour un temps donné, plus une machine fournira de travail plus elle sera puissante.
Définition de la puissance
La puissance d'une machine est l'énergie qu'elle fournit en 1 seconde.
La puissance se note P.
Elle se mesure en Watt.
W en Joule
t en seconde
P en Watt
Par extension nous avons W = P . t
Si t est en heure, W s'exprime en Wattheure.
Remarque :
On rencontre encore en mécanique comme unité de puissance, le cheval-vapeur (ch ou CV).
1 ch = 736 W
Rendement
Le rendement est le rapport entre Wu et Wa ;
or
Wu = Pu . t
et
Wa = Pa . t
Avec :
Pu = puissance utile
Pa = puissance absorbée
Energie et puissance électrique
Energie électrique
Si le récepteur est soumis à une tension U et qu'il est traversé par un courant d'intensité I pendant un temps t il va absorber de l'énergie électrique.
Cette énergie est notée W
W = U.I.t
Avec :
U en Volt
I en Ampère
t en seconde
W en Joule
Remarque: si le temps t est mesuré en heure, W est obtenu en Wattheure ; (Wh).
Le wattheure : 1 Wh = 3600 J
le Kilowattheure : 1 KWh = 1000 Wh = 3 600 000 J
Mesure de l'énergie électrique
L'énergie électrique qui nous est fournie par le réseau électrique est mesurée par un compteur (watt-heuremètre ou énergiemètre) placé à l'entrée de l'installation. Cet appareil est gradué en Kilowattheure. Anciennement les compteurs utilisés possédaient un disque d'aluminium qui tournait plus ou moins vite selon les appareils qui étaient en fonctionnement. Un tour de disque correspondait à l'enregistrement d'une énergie appelée constante du compteur (cette valeur, notée K, est indiquée sur l'appareil ; exemple : K 2 Wh /tr).
Actuellement avec les nouvelles options tarifaires, les distributeurs d'énergie électrique installent des compteurs électroniques.
Symbole du wattheuremètre :
En courant continu ou pour un appareil résistif, l'énergie consommée peut être obtenue en mesurant la tension, l'intensité du courant, le temps de fonctionnement et en faisant le produit de ces trois valeurs.
Puissance électrique
Rappels :
et W = U.I.t
D'ou : 
donc : P = U . I
Avec :
U en Volt
I en Ampère
P en Watt
La puissance fournie par le générateur est égale la puissance absorbée par le récepteur.
Mesure de la puissance électrique
On utilise un Wattmètre . C'est un appareil qui possède des bornes "intensités" qui seront raccordées en série avec le récepteur ou par une pince ampèremètrique et des bornes "tensions" qui seront raccordées en parallèle sur le récepteur.
Si l'aiguille de l'appareil dévie dans le mauvais sens il faut inverser le branchement des bornes intensités ou celui des bornes tensions.
Pour les appareils de mesures électroniques et numériques la valeur se lit directement. En courant continu ou dans le cas de récepteur résistif, la puissance peut être obtenue en mesurant la tension et l'intensité du courant et en faisant le produit de ces deux valeurs.
Il existe maintenant des appareils de mesure qui, sous la forme d'une pince ampèremètrique, sont capables de mesurer la puissance, l'intensité, la tension, et d'autres grandeurs physiques (fréquence, harmoniques, Cos phi...)
Exercices sur la puissance, la quantité d'électricité et l'énergie
1 - Une batterie d'accumulateurs a fournie une quantité d'électricité de 60.000 Coulombs pendant une minute.
Calculer l'intensité du courant débité par la batterie.
2 - Une batterie d'accumulateurs se décharge complètement en trois heures lorsqu'elle débite 10 Ampères.
Calculer la capacité de la batterie en ampères-heures.
3 - Une lampe à incandescence fonctionne 10 heures par jour et est traversée par un courant de 0,8 A.
Calculer en Ampères-heures et en Coulombs la quantité d'électricité consommée en un mois de trente jours.
4 - Un récepteur alimenté sous une tension de 100V est traversé par un courant de 5 A pendant deux heures.
Calculer la puissance du récepteur.
Calculer l'énergie absorbée par ce récepteur.
5 - Un récepteur est traversé par un courant de 10 ampères pendant 3 s.
Calculer la quantité d'électricité absorbée par ce récepteur.
Calculer l'énergie absorbée par ce récepteur s'il a été alimenté sous une tension de 400 V.
6 - Un récepteur soumis à une tension de 100 V absorbe une puissance de 900W.
Calculer l'intensité du courant qui le traverse.
7 - Un moteur électrique est traversé par un courant continu d'intensité de 6 A sous 120 V.
Calculer la puissance qu'il absorbe.
8 - Un récepteur qui absorbe une puissance 1500 W est traversé par un courant de 8 A.
Calculer la tension à laquelle est soumis ce récepteur
Résistance électrique
La résistance électrique d'un matériau est sa faculté d'empêcher le passage du courant. Cette valeur est indépendante du circuit dans lequel se trouve ce matériau.
La résistance se note R et elle se mesure en Ohm (symbole Ω)
Résistance d'un conducteur
Réalisons deux circuits électriques composés d'un ampèremètre, d'une lampe et alimentés par le même générateur.
Expérience sur l'influence de la longueur

L1 éclaire moins que L2 car le courant circule moins dans le fil le plus long.
Dans le fil 1, les électrons ont un chemin plus long à parcourir. Ils rencontrent donc plus d'atomes qui les freinent sur leur parcourt : la résistance d'un fil augmente quand sa longueur s'accroît.
Influence le la section

L2 éclaire moins que L1 car le courant circule avec plus de difficulté (donc moins) dans le fil le plus fin.
Dans le fil 1, les électrons sont plus dispersés et les chances de choc contre les atomes sont diminuées. Dans le fil 2 c'est le phénomène inverse : la résistance d'un fil augmente quand sa section diminue.
Influence de la nature du conducteur

L1 éclaire moins que L2 car le courant circule moins bien dans le fil de Nickel-Chrome.
La résistance d'un fil dépend donc de la nature du matériau.
Calcul de la résistance
Les mesures faites simultanément par Ohm et Pouillet sur des conducteurs de section cylindrique ont conduit séparément ces deux savant à énoncer la loi suivante :
La résistance R d'un conducteur filiforme si sa section est constante est :
proportionnelle à sa longueur l,
inversement proportionnelle à sa section s,
variable avec la nature du conducteur.
Cette loi se traduit par la formule :
l est en mètre,
s en m²,
ρ en Ω.m
R en Ω
ρ étant un coefficient de proportionnalité qui exprime le pouvoir conducteur d'un matériau.
Résistivité
Dans l'expression précédente ρ caractérise la nature du conducteur. Ce coefficient ρ (prononcer ro) s'appelle la résistivité . Plus cette valeur est faible, plus le matériau est conducteur. Par exemple, la résistivité du fer est environ 6 fois plus grande que celle du cuivre, on en déduit que le cuivre est 6 fois plus conducteur ; elle se mesure en Ohm.mètre.
L'unité de résistivité d'un échantillon de conducteur
a R = 1 Ω, l = 1 m et s = 1 m2 est égale à :
avec :
ρ en Ω.m
R en Ω
s en m2
l en mètre
Valeur usuelles de résistivités
- métaux usuels ρ ± = 2.10-8 Ω.m
- semi-conducteur 10-5 Ω.m < ρ <>9 Ω.m
- isolants ρ > 109 Ω.m
Cas d'un conducteur de cuivre
La formule pratique est la suivante :
à 15°C avec ρ ± 1,74 Ω.m, l en mètre et s en mm2
Valeurs pour d'autres conducteurs
Tableau des résistivités des principaux conducteurs employés en électricité ou électronique.
| Conducteurs | ρ en Ω . m | α |
|---|---|---|
| argent | 1,64.10-8 | 3,85.10-3 |
| cuivre | 1,72.10-8 | 3,93.10-3 |
| aluminium | 2,69.10-8 | 4,03.10-3 |
| nickel | 7,8.10-8 | 5,37.10-3 |
| fer | 9,8.10-8 | 6,5.10-3 |
| constantant | 50.10-8 | 0 |
| charbon | 40.10-8 | -0,4.10-9 |
Conductivité et conductance
L'inverse de la résistivité s'appelle la conductivité (γ se lit gamma).
L'inverse d'une résistance est une conductance (symbole G) elle s'exprime en Siemens.
Mathématique et courant alternatif sinusoïdal
Mesure des angles
Le radian (rd)
C'est l'angle au centre qui intercepte entre ces deux côtés, sur la circonférence, une longueur d'arc égale au rayon.
Si L = longueur ou périmètre du cercle et,
si un cercle correspond un angle de 360°
Nous déduisons donc :
L = ¶D = 2¶R
comme R = rd
alors L = 2¶rd
d'ou : 2¶rd = 360°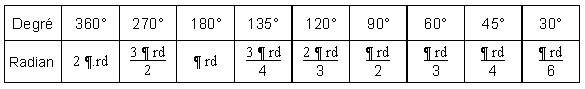
Conversion de degré vers radian :
Exemple : 72° = ? rd
Conversion de radian vers degré :
Exemple :
Rapports trigonométriques
Définitions :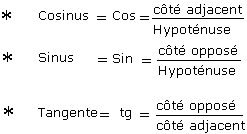
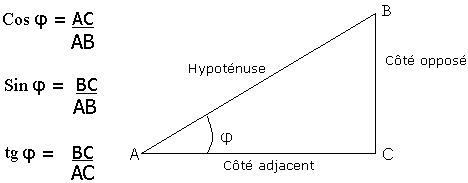
Notons quelques valeurs particulières
Cercle trigonométrique
Soit un cercle de centre O et de rayon égal à l'unité (exemple 1 dm) :
traçons les axes x x' ; y y' ; passant par le centre du cercle et l'axe z z' tangent au cercle ;
comptons positivement les angles à partir de OT et dans le sens anti-horaire (sens trigonométrique).
Dans le triangle rectangle OMC :
- L'axe x x' est l'axe des cosinus
- L'axe y y' est l'axe des sinus
Dans le triangle rectangle OAT :
- L'axe z z' est l'axe des tangentes
Ainsi par une lecture directe sur l'un des trois axes indiqués nous pouvons déterminer rapidement la valeur des rapports trigonométriques d'un angle.
Tracé d'une sinusoïde
Puisque le point M peut décrire tout le cercle, l'angle phi peut donc prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 2¶rd et nous pouvons remarquer alors que toutes les valeurs d'angle sont définies par leur sinus.
Nous pouvons donc représenter graphiquement les variations de sinus phi en fonction de l'angle.
La courbe ainsi obtenue se nomme une sinusoïde.

Le condensateur
En 1745, à Leyde, trois savants (dont Cuneus et son professeur Musschenbroeck) inventent le condensateur plus connu sous la forme de "la bouteille de leyde".
Le condensateur moderne existe sous de nombreuses formes et ses domaines d'application se situent principalement en électricité (batterie de condensateur pour l'amélioration du cos phi ou facteur de puissance) et en électronique.
Il est largement utilisé pour le filtrage des alimentations électroniques (condensateur chimique de grande capacité), l'accord des circuits hautes fréquences (téléphone mobile, satellites...), le couplage ou découplage de circuits...
Les progrès techniques aidant, les "super-condensateurs" (condensateurs de très grande capacité) vont commencer à remplacer les piles de sauvegarde de certaines mémoires. Les recherches en cours nous font se demander ou est la véritable frontière condensateur / accumulateur...
Définition du condensateur
On appelle condensateur l'ensemble de deux surfaces conductrices ou armatures, séparées par un isolant ayant une permittivité (ou constante diélectrique) donnée. L'isolant est souvent appelé "diélectrique".
=> Deux feuilles d'aluminium séparées par une feuille de papier paraffiné forment un condensateur.
Symbole du condensateur
Caractéristiques physiques du condensateur
Description d'un condensateur industriel
Ce type de condensateur est constitué de deux longues feuilles d'aluminium ou d'étain, séparées par deux longues bandes de papier. L'ensemble est enroulé et comprimé. Les feuilles métalliques sont les armatures, et le papier, le diélectrique. Chaque armature est reliée à une borne. Les gros condensateurs sont plongés dans une cuve pleine d'huile pour améliorer l'isolement.

Caractéristiques électriques du condensateur
Capacité d'un condensateur
La capacité d'un condensateur mesure son aptitude à emmagasiner (ou stocker) des charges électriques sur ces armatures.
La capacité s'exprime en farad.
Mathématiquement la capacité d'un condensateur est déterminé par :
La capacité d'un condensateur est de 1 farad si une différence de potentielle de 1 volt entre ses armatures y dépose une charge de 1 coulomb (1 coulomb = 1 ampère pendant 1 seconde). Le farad étant une unité très grande, nous utiliserons plus couramment ses sous-unités :
Le farad étant une unité très grande, nous utiliserons plus couramment ses sous-unités :
- le millifarad (mF) : 1mF = 10-3 Farad (filtrage pour ampli audio haut de gamme)
- le microfarad (µF) : 1µF = 10-6 Farad (filtrage alimentation cartes électroniques)
- le nanofarad (nF) : 1nF = 10-9 Farad (découplages et filtres actifs)
- le picofarad (pF) : 1pF = 10-12 Farad (circuits haute fréquence)
Physiquement, par sa construction mécanique, la capacité d'un condensateur est déterminer par :
- La surface des armatures
- L'épaisseur du diélectrique (isolant)
- La nature du diélectrique ou sa permittivité  (epsilon).
(epsilon).
Exemples de permittivité
=>  mica = 8
mica = 8
=>  verre = 6
verre = 6
=>  air = 1,000576
air = 1,000576
Tension de service d'un condensateur
Lorsque les armatures d'un condensateur sont soumises à une tension trop élevée, une étincelle perce le diélectrique ;
le condensateur est alors hors service. Ce phénomène est appelé claquage du condensateur.
La tension de service d'un condensateur est la différence de potentielle maximale que l'on peut appliquer à ces armatures sans l'endommager.
Elle dépend essentiellement de la qualité du diélectrique et de son épaisseur ; nous parlons alors de rigidité du diélectrique (KV/mm).
Notion de rigidité diélectrique
Pour tout diélectrique, il existe une tension sous laquelle le diélectrique est percé par le passage d'un courant.
On dit alors que le diélectrique claque.
La rigidité diélectrique qualifie un isolant de la d.d.p. qu'il faut lui appliqué par millimètre d'épaisseur pour qu'il claque(KV/mm).
Plus elle est grande et plus notre condensateur verra sa tension de service augmentée.
Exemples
air = 3 KV / mm
papier paraffiné = 51 KV / mm
verre = 118 KV / mm
Groupement de condensateurs
Condensateurs associés en parallèle

Q1 = U.C1
Q2 = U.C2
Q3 = U.C3
Q totale = Q1 + Q2 + Q3 = U(C1 + C2 + C3) = U Ceq
D'ou : Ceq = C1 + C2 + C3 + ...
Si nous associons plusieurs condensateurs en parallèle, la capacité équivalente de l'ensemble est égale à la somme des capacités des condensateurs associés.
Condensateurs associés en série

Tous les condensateurs en série se chargent à la même quantité d'électricité Q,
d'ou : Q = C1.U1 = C2.U2 = C3.U3 et Q = Ceq U
Avec : U = U1 + U2 + U3
Nous avons :
d'ou :
Si nous associons plusieurs condensateurs en série, la capacité équivalente est telle que son inverse soit égale à la somme des inverses des capacités des condensateurs associés.
Tableau des propriétés de différents diélectriques
Le facteur de puissance ou cosinus phi
Définition
Le facteur de puissance appelé également Cosinus  (lire cosinus Phi) est le déphasage angulaire entre la tension et l'intensité du courant dans un circuit alternatif.
(lire cosinus Phi) est le déphasage angulaire entre la tension et l'intensité du courant dans un circuit alternatif.
Étude du cos phi ou facteur de puissance
Dans son ensemble un réseau alternatif distribue de la puissance active et de la puissance réactive.
Les puissances wattées (puissances actives) s'additionnent entre elles :
Pt = P1 + P2 + P3 + Pn...
Les puissances réactives s'additionnent entre elles :
Qt = Q1 + Q2 + Q3 + Qn...
Il y a donc intérêt à avoir un bon Cos  (Cos phi proche de 1 d'où un angle phi petit) car si le Cos phi est petit (déphasage important) pour une puissance wattée donnée il faudra fournir une puissance "S" plus grande d'où une intensité plus grande.
(Cos phi proche de 1 d'où un angle phi petit) car si le Cos phi est petit (déphasage important) pour une puissance wattée donnée il faudra fournir une puissance "S" plus grande d'où une intensité plus grande.
Exemple :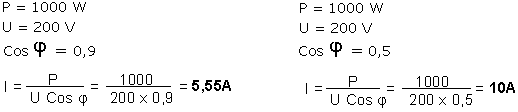
Inconvénient d'avoir un mauvais facteur de puissance
Pour le producteur :
- nécessité d'avoir des alternateurs et des transformateurs plus importants,
- posséder une tension plus élevée au départ de la ligne,
- besoin d'avoir des lignes de plus forte section,
- pertes Joules plus élevées,
- appareils de contrôle, de protection et de coupure plus importants.
Pour le consommateur :
- nécessité d'avoir des transformateurs, des moteurs, des appareillages de manœuvre plus importants,
- tension d'utilisation plus faible,
- intensité plus grand,
- pertes Joules plus élevées,
- rendement des appareils mauvais.
Amélioration du facteur de puissance
Détermination des capacités des condensateurs pour relever le facteur de puissance à une valeur donnée :
Puissance réactive fournie par un condensateur :


Exercice :
Un réseau 200V 50Hz absorbe une puissance active de 80 KW, une puissance réactive de 60 KVAR.
Déterminer le Cos phi de l'installation.
Nous désirons ramener le Cos phi à 0,85 ; calculer la capacité du condensateur à brancher sur ce réseau.
Sugestion : pour déterminer le Cos phi vous utiliserez la méthode gragphique puis vérifirez par le calcul.
Le démarrage étoile triangle
Le démarrage étoile triangle est très utilisé en électrotechnique pour la mise en marche des moteurs électriques asynchrones triphasés. On trouve assez facilement des ressources libres de schémas électriques de démarrage étoile triangle. Mais pourquoi choisir un tel dispositif ? Cette page vous donne une explication du point de vue électrotechnique et la démarche mathématique qui conduit à la compréhension du dispositif de démarrage étoile triangle
Problème posé
On dispose de trois récepteurs identiques d'impédance Z, d'un facteur de Puissance Cos  et d'un réseau triphasé de tension simple V ; de tension composée U.
et d'un réseau triphasé de tension simple V ; de tension composée U.
Ecrire la formule qui donne l'intensité en ligne quant on couple les trois récepteurs en étoile, puis quant on les couple en triangle.
Etudié le rapport :  .
.
Ecrire la formule qui donne la puissance en étoile puis en triangle.
Etudié le rapport :  .
.
Convention d'écriture : un triangle ( ) en indice d'une grandeur signifie que l'on considère cette grandeur dans le mode de couplage triangle.
) en indice d'une grandeur signifie que l'on considère cette grandeur dans le mode de couplage triangle.
Une étoile (Y ou  ) en indice d'une grandeur signifie que l'on considère cette grandeur dans le mode de couplage étoile.
) en indice d'une grandeur signifie que l'on considère cette grandeur dans le mode de couplage étoile.
Position étoile
Considérons le schéma suivant où nos trois récepteurs sont couplés (branchés) en étoile :
Intensité en ligne
Nous avons : Intensité en ligne = Intensité récepteur (IL = IZ) soit :
Puissance en étoile
Calculons :
Position triangle
Considérons le schéma suivant où nos trois récepteurs sont couplés en triangle :
Intensité dans chaque récepteur
Intensité en ligne
Nous savons que :
Puissance en triangle
Calculons :
Étude des rapports
Étude du rapport Itriangle sur Iétoile
Étude du rapport Ptriangle sur Pétoile
Conclusion
Cette propriété est utilisée pour les démarrages des moteurs asynchrones triphasés où au premier temps les enroulements sont couplés en étoile (In et P 3 fois plus faible) et au deuxième temps on effectue le couplage triangle .
Il en résulte de la même façon que le couple de démarrage en étoile est trois fois plus faible qu'en triangle.
Schéma du démarrage étoile triangle
Le démarrage étoile triangle est très utilisé en électrotechnique pour la mise en route des moteurs électriques asynchrones triphasés. Ce dispositif est employé afin de diminuer les "risques" du démarrage direct. En effet, l'intensité du courant au démarrage (en direct) est très importante vis à vis du courant nominal du moteur (environ 5 à 7 fois l'intensité nominale). Sur les gros moteurs ces courants importants entraînent des surcharges sur les lignes d'alimentations (fils, câbles, bornes) et sur les appareils de protection et de commande (fusible, sectionneur, contacteur, relais thermique...) d'ou une usure, voir une destruction, prématurée des composants du démarreur.
Cas du démarrage direct
Si nous relevons les valeurs de l'intensité (I) d'un courant et du couple (C) d'un moteur triphasé au moment du démarrage, nous obtenons les courbes suivantes.
Nous observons qu'au moment du démarrage les valeurs de I et de C sont respectivement 7 et 2 fois plus grandes que leur valeur en régime établi.
Voir le schéma du démarrage direct (fichier pdf format A4). Voir le schéma du démarrage direct deux sens de marche (fichier pdf format A4).
Pour réduire l'intensité au démarrage du moteur, l'étude du rapports I Triangle/I Etoile (voir cours démarrage étoile-triangle) nous montre qu'il serait préférable de démarrer un moteur (asynchrone triphasé à rotor en court circuit) en le couplant en étoile.
Par contre si l'on veut exploiter le couple et la puissance maximum du moteur il faut le brancher en triangle.
Couplage étoile :
Couplage triangle :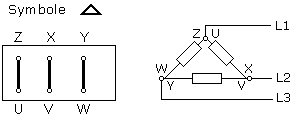
Le démarrage étoile triangle
Conditions à remplir :
Le couplage triangle doit correspondre à la tension du réseau.
Le démarrage du moteur doit se faire en deux temps.
Premier temps : couplage des enroulements en étoile et mise sous tension ;
Deuxième temps : suppression du couplage étoile, immédiatement suivie du couplage triangle.
Analyse du fonctionnement au démarrage :
Au démarrage le moteur est couplé en étoile. La tension appliquée sur une phase est réduite, soit  .
.
L'intensité absorbée (proportionnelle à la tension appliquée) est le 1/3 de celle qu'absorberait le moteur s'il démarrait directement en triangle. La valeur de la pointe de l'intensité atteint en général deux fois l'intensité nominale.
Le couple au démarrage (proportionnel au carré de la tension appliquée) et le couple maximum en étoile sont ramenés au 1/3 des valeurs obtenues en démarrage direct. La valeur du couple de démarrage atteint en général 0,5 fois le couple nominal.
Coupure (passage étoile triangle) :
Le temps de passage entre les deux couplages doit être très bref.
Couplage triangle :
Un deuxième appel de courant se manifeste ; il est fonction de la durée du couplage étoile et peut atteindre la valeur de pointe du démarrage direct. Cette pointe de courte durée provient du fait que les forces électromotrices qui subsistent au stator lors du couplage triangle ne sont pas en opposition de phase avec les tensions de ligne.
Le couple subit une forte pointe pour retomber rapidement à sa valeur nominale.
Commande automatique d'un démarrage étoile triangle
Exemple d'un schéma du circuit de commande :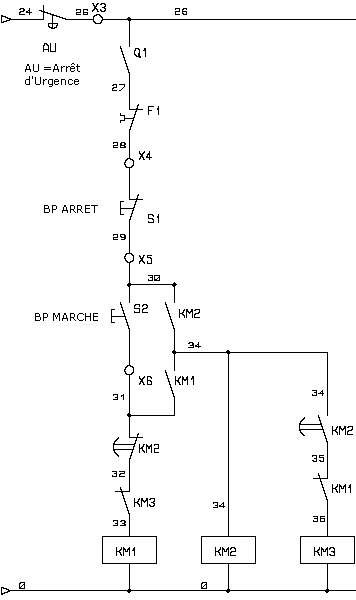
La commande est effectuer par des boutons poussoirs momentanés (S1 et S2).
Une impulsion sur le bouton poussoir MARCHE (S2) met la bobine du contacteur étoile (KM1) sous tension et ferme son contact ; ce dernier alimente KM2 le contacteur de ligne. Le contact KM2 étant maintenant fermé, il auto alimente la bobine KM2, démarre le cycle de la temporisation et permet l'auto maintient du contacteur KM1. Nous pouvons noter qu'un contact de KM1 interdit la mise sous tension de KM3.
Dans cette phase le moteur est couplé en étoile et prend de la vitesse.
La temps préréglé du dispositif de temporisation s'écoule et les contacts de la temporisation se déclenchent ;
La bobine KM1 n'est plus alimentée (le contact NC temporisé KM2 s'ouvre) et de ce fait autorise l'alimentation de KM3 conjointement avec le contact NO de temporisation KM2.
KM3 s'enclenche et permet au couplage triangle d'être effectif.
Nous pouvons noter qu'un contact de KM3 interdit la mise sous tension de KM1 (ce dispositif est un ou exclusif appelé verrouillage électrique).
Une impulsion sur le bouton poussoir S1 (BP ARRET) arrête le moteur.
Voir et télécharger le schéma de commande au format PDF en A4
Voir et télécharger le schéma de puissance au format PDF en A4
Exemple d'un schéma du circuit de puissance :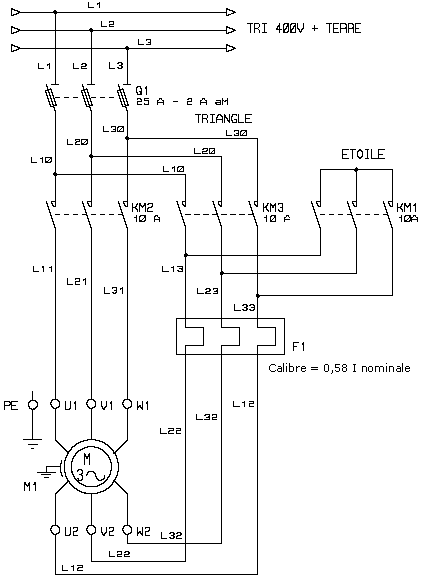
Notions de courant faible
Le courant faible est une dénomination utilisée pour désigner les courants qui circulent sur les voies de communication.
En effet les installations "courant faible" sont présentes dans les domaines de la téléphonie, des transmissions de données, des transmissions numériques en générales, de l'alarme et de la signalisation...
Installation courant fort
Installation distribuant l'énergie électrique destinée à être transformé par les récepteurs ayant pour fonctions l'éclairage, le chauffage et la force motrice (lampes, résistances, moteurs, appareils électrodomestiques, materiels de bureau...). Les courants mis en causes sont de l'ordre de quelques centaines de mA à plusieurs KA.
Installation courant faible
Installation visant à diffuser, recueillir ou échanger de l'information sous forme de signaux électriques ou optiques. Les applications concernées sont multiples : téléphonie, radiocommunication, réseau informatique, automatisme, domotique audio, vidéo...
Les courants mis en causes sont parfois très faible (quelques µA).
Notion de réseau
Definition de réseau
nom masculin de rets => du latin retis "filet" ;
répartition des éléments d'une organisation en différents points, chaque point est relié à un autre par un lien.
En électricité
Installation visant à mettre en relation des fournisseurs d'énergie électrique (centrales électriques) et des consommateurs d'énergie (abonnés).
Les centrales de production d'énergie électrique, les consommateur d'énergie électrique et les fils électriques (lignes haute tension / basse tension) forment le réseau électrique.
En téléphonie
Installation visant à mettre en relation vocale ou sonore des humains (abonnés).
Les appareils téléphoniques, les centraux téléphoniques (commutateurs automatiques) et les fils de cuivre ou fibres optiques forment le réseau téléphonique (voir RTC - Réseau Téléphonique Commuté -).
D'une façon générale
Un réseau est un groupe d'éléments reliés entre eux pour communiquer à l'aide d'une voie ou canal.
Commentaires
Enregistrer un commentaire